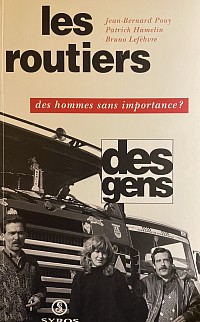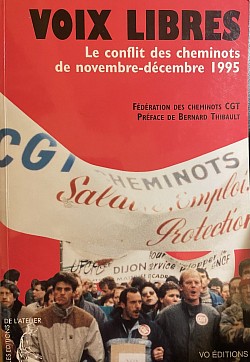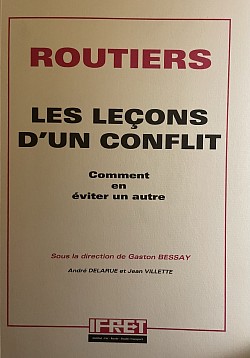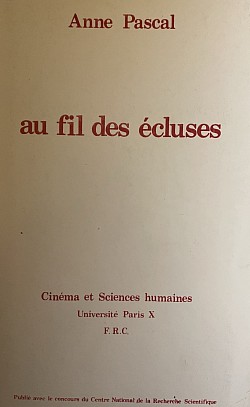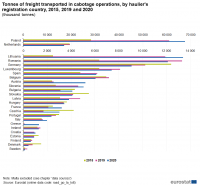Les questions sociales
La question sociale : entre désintérêt et méconnaissance statistique
La perception des questions sociales dans les transports terrestres a fortement évolué dans le temps. Longtemps marquée par la nature même de la production ferroviaire et sa place dominante dans l’économie des transports, on a souvent négligé les conditions sociales propres au transport routier et fluvial, et concentré son attention sur la conflictualité ferroviaire, qui anime par ailleurs largement l’évolution du nombre de jours de grèves dans le temps.
A cet égard certains mouvements ont marqué l’histoire sociale et politique des transports aussi bien au XIXème qu’au XXème siècle (voir : pour la SNCF)
Pour autant, des mouvements importants, caractérisés par des barrages ou des blocages de circulation ont existé dans les autres modes terrestres. Ainsi, par exemple en est-il des mouvements routiers (entreprises et conducteurs) de 1984, 1992 et 1996, ou ceux des bateliers des années 1985-1986.
Il est assez frappant de constater cependant que ces différents mouvements sont loin d’avoir la même nature, et ne concernent pas toujours directement les conditions et l’organisation du travail.
S’agissant du conflit routier de 1992, Claude Debons et Joël Le Coq nous expliquent que « pour la première fois à cette échelle, les salariés du transport routier ont commencé à se dégager de la tutelle patronale pour répondre à l’appel unitaire de leurs organisations syndicales ». Et d’une certaine manière le conflit de 1996 résulte en partie du ressentiment ou de la déception tirée de l’accord de 1994 (contrat de progrès) consécutif au conflit de 1992. La mobilisation concerne clairement les conditions de travail et de rémunération. Au contraire, les conflits bateliers relèvent d’une autre logique, celle de l’accès aux différents marchés de la voie navigable (artisans vs compagnies), et des conditions de départ en retraite des mariniers. On notera que ceux-ci ont bénéficié d’une chambre des métiers propre (la CNBA, crée en 1985) aujourd’hui supprimée (2019 : voir). Les bateliers qui, jadis, chercher leur fret au « tour de rôle » institué en 1938, sont désormais « affrêtés » sur un marché « libre », et ont désormais une activité commerciale. On ne dispose cependant que de peu de données décrivant leur activité et leurs conditions de travail.
Désintérêt ?
La question des conditions de travail et de rémunération est finalement largement méconnue et étudiée pour les travailleurs mobiles, et singulièrement pour les activités comme la route et la voie d’eau, tandis que le rail constitue un cas « à part », les travailleurs étant régis par un « statut » (celui-ci naissant en 1920). Or, la grande différence entre le transport ferroviaire et ses concurrents terrestres, tient à ce que non seulement dans les modes routiers cohabitent des travailleurs indépendants et des salariés, mais que l’organisation du travail sur la voie publique n’y est que très rarement encadré par une organisation de type industrielle et stricte. Ce qui conduit à une large méconnaissance des conditions réelles de travail.
Ce phénomène s’est aujourd’hui élargi à d’autres professions dont la croissance est récente, comme les activités de livraison de colis (souvent par des indépendants), et le travail « logistique » en entrepôt. Une ignorance « sociale » vient ici se rajouter à la méconnaissance statistique.
La route étudiée, les autres professions non
Il convient cependant de s’interroger sur l’intérêt relatif aux conditions sociales. Si des bilans spécifiques apparaissent pour le transport routier (bilans annuels) – ce qui n’empêche nullement de s’interroger sur la nature des statistiques produites (voir plus bas), rien de tel n’est publié par les services statistiques sur la batellerie, la livraison de petits colis, ou la logistique. Le bilan annuel des transports (anciennement rapport de la commission des comptes des transports de la nation) est totalement muet sur ces questions.
On peut raisonnablement se poser la question de cette absence. Elle était souvent abordée au cours des séances de la Commission sociale du Conseil National des Transports (aujourd’hui disparu) dont les rapports ne produisaient que des données rendant mal compte des réalités sociales.
De même, pour ce qui concerne la batellerie, la description de la nature et de l’organisation du travail et les statistiques y afférant ne franchissaient guère les limites de ce qui était l’Office National de la Navigation (aujourd’hui Voies Navigables de France), et de quelques rares recherches (comme celles de François Lille & alii dans les années 1970). Il est frappant de noter qu’il n’existe plus de statistiques dans ces domaines.
La situation est la même globalement pour les travailleurs indépendants exploitant des Véhicules Utilitaires légers, la logistique et même pour le travail des cheminots. L’open-data de la SNCF (qui ne couvre donc pas la totalité du travail des cheminots) ne traite pas des conditions de travail.
Des données discutées
Les données publiées désormais régulièrement dans le cadre du « bilan social » du transport routier découlent de l’analyse des tachygraphes, c’est-à-dire de l’outil embarqué de contrôle (disque ou carte électronique). Cette méthode a été critiquée par Patrick Hamelin qui est à l’origine des études fondées sur l’exploitation de carnets de temps remplis par les conducteurs, qui débouchent sur des durées d’activité généralement supérieures à celles révélées par l’exploitation des tachygraphes. L’écart a pu être estimé au début des années 2000 à environ 3 heures.
Pour autant, l’examen des chiffres publiés, fait apparaitre des différences plus notoires. Ainsi pendant les années 2000 le temps de service des grands routiers serait compris entre 47 et 48 heures par semaine en moyenne, contre 56 à 59 heures/semaine entre 1983 et 1999. Un écart difficile à justifier et qui laisse dubitatif.
Compter quoi ?
La question centrale pour les travailleurs mobiles est de savoir comment ventiler et compter le temps de non conduite entre pauses, repos, attente, travail etc… Or la définition du temps de travail, du temps à disposition, ou du temps de service— détermine pour les salariés celle le décompte des heures et de leur rémunération. C’est bien la notion – sacralisée d’équivalence – entre des activités de nature différente qui permet théoriquement de passer outre les limites de durée de travail de droit commun. On voit bien dès lors l’enjeu de leur mesure dans une entreprise, et par comparaison chez les artisans, et de leur mesure globale au niveau statistique. Or, l’instrument majeur de régulation sur le terrain, réside dans le seul contrôle des dispositions des règles européennes portant sur l’articulation conduite-pause-repos. Si effectivement et majoritairement ces règles structurent les conditions de concurrence, le reste (travail, service, mise à disposition) concerne les rapports entre travailleurs salariés et employeurs, et non entre transporteurs et clients. D’ailleurs, l’introduction maladroite de la responsabilité du donneur d’ordre (dans la LOTI) dans le respect des règlementations « sociales », est désormais oubliée..
La connaissance des réalités sociales et la qualité de cette connaissance ont une influence directe sur l’appréciation que l’on peut avoir non seulement de l’application des textes réglementaires mais aussi des conditions de concurrence éventuelle entre transporteurs de différentes nationalités. Cette question pose donc à la fois celle de l’appareil d’observation statistique, mais aussi de la connaissance des textes européens et nationaux applicables.
Cette connaissance a fait l’objet de travaux menés ou accompagnés par l’OEST et le CEDIT dans les années 1980-90, puis par le PREDIT (partiellement). Ils ne sont pas directement réitérés, sauf à travers les monographies du Comité National Routier (CNR).
Les questions sociales sont peu ou pas évoquées directement dans la description (largement absente) des conditions de travail ferroviaires et fluviales. Ainsi, le débat sur le statut de la SNCF (initié par le rapport de J.C Spinetta « L’avenir du Transport ferroviaire » en 2018), a pu être mené sans qu’on ne dispose d’une information statistique publique portant sur les durées effectives de travail, et le coût de la main d’œuvre du transport ferroviaire. Les estimations alors avancées d’écart de productivité ou de compétitivité étaient largement invérifiables, et non vérifiées.
Les auto-entrepreneurs
Abandonnant progressivement ce terrain des conditions de travail et de leur incidence sur la concurrence, l’intérêt public s’est récemment porté sur les auto-entrepreneurs qui se sont portés massivement sur le marché des VTC pour les voyageurs et du transport de colis, généralement pour le compte d’expressistes géants ou d’entreprises comme Amazon.
Ce mouvement, dont on a une image statistique assez claire, a été souligné par Sergio Bologna (Le Mouvement des Freelances,, Editions Smart 2016). Sa singularité mondiale est une extension brutale et très importante du travail indépendant, dans un secteur de plus en plus dominé par des grandes entreprises, et l’économie numérique des plates-formes. On retrouve ainsi des formes d’organisation du travail qui, y compris dans les transports, ont eu cours dès le XIXème siècle et perdure dans le transport routier et la navigation fluviale. Malheureusement, les données statistiques manquent pour le décrire avec précision. Ce qui change ici, par rapport à la petite entreprise, c’est la nature du contact avec le client/donneur d’ordre, qui n’existe pas, le travail étant rémunéré à la tâche. Historiquement, en France, selon le Bilan annuel des transports en 2020, 2016 est la première année où les immatriculations de nouvelles micro-entreprises dépasse la création d’entreprises « classiques » dans les transports (voyageurs et marchandises). Pour les années 2016-2020, les microentreprises représentent dans l’ensemble du transport (voyageurs et marchandises) et de l’entreposage 67,4 % des créations.
La méconnaissance statistique des conditions de travail et de rémunération de ces micro-entrepreneurs pose un problème de même nature que celui que pose le recours – par des grandes entreprises – à des « tractionnaires » routiers, singulièrement d’Europe de l’Est. C’est ainsi un maillon essentiel de l’offre de transport qui est méconnu.
Il reste que les données par secteur d’activité donnent des indications sur les conditions d’exploitation de ces micro-entreprises. Ainsi, les entreprises dites d’activité de poste et de courrier ont des taux de marge brute fortement négatifs, et leur marge nette est faible voir négative.
La demande sociale
L’intérêt des « statisticiens » pour les questions sociales n’est pas indépendant des demandes des pouvoirs publics et de la conjoncture sociale. Il est évident par exemple que la publication de chiffres permettant d’estimer l’importance des micro-entreprises coïncide avec l’explosion de leur nombre. Il reste que certains domaines peinent à être couverts. Et certaines données sont trompeuses. Ainsi, le taux de sous-traitance ne permet nullement de décrire sa nature, la sous-traitance entre entreprises d’un même groupe apparaissant de la même manière que celle avec des entreprises unipersonnelles.
Le rapport de M. Damien PICHEREAU, parlementaire en Mission en 2018, souligne par exemple à juste titre l’importance des durées de tournées, sans pouvoir en donner une estimation.
Quelques grands conflits
Nous avons fait le choix de ne pas traiter de tous les métiers, de tous les secteurs, comme par exemple de la manutention portuaire et des dockers, pas plus de des conflits ayant marqué l’histoire de la SNCM. C’est un choix centré sur des conflits marquants, s’emparant de l’essentiel du territoire national, et historiquement révélateurs.
Les conflits
Depuis la seconde guerre mondiale, de grands conflits touchant les transports sous la forme de grandes grèves, ont concerné à peu près tous les modes. Conflit pour le pilotage « à deux », grève du contrôle aérien, des transports collectifs urbains, de la SNCF, des bateliers, des routiers, de la SNCM… la liste est longue. Mais si la nature et les conséquences de ces mouvements diffèrent profondément, le blocage des transports révèle leur rôle central puisqu’il touche directement à la circulation marchande ou à la mobilisation de la main d’œuvre. Si la grève des transports collectifs provoque la thrombose, celle des transports de marchandises fait naître la crainte de pénuries et d’une sorte de grande panne de l’économie, l’une et l’autre faisant émerger des positions radicales, idéologiques et politiques. Liberté de circulation ou de déplacement, contre liberté de grève.
Mais si l’on devait chercher une typologie, il faudrait distinguer entre les mouvements globaux – et de ce point de vue les grandes grèves cheminotes ont ce caractère, comme les grands blocages routiers – et les mouvements locaux. Même si les uns et les autres se combinent ou s’empilent. Comme en 1936 ou 1968, ou plus récemment en 1996 comme le rappelle J.F. Revah dans une recherche pour le Predit : « L’automne 1996 connait successivement le conflit majeur des routiers, celui de la compagnie maritime SNCM, une agitation sporadique dans les secteurs aérien (groupe Air France, AOM, etc.), ferroviaire (SNCF), urbain, (Toulouse, Rouen, etc.) et interurbain (Chelles, etc .). »… et son énumération d’une page égrène une longue liste de deux années de conflits. Ce qui frappe le psychosociologue est alors l’immobilisme du milieu professionnel qu’il convient de comprendre… pour éviter la répétition des conflits.
Il y a cependant des mouvements paroxystiques, qui marquent l’histoire. Citons simplement dans la période récente la grande grève de la SNCF de 1995, celle des routiers de 1984 et celle de 1996 (syndicalement organisée) en contrepoint de celle de 1992, celle des bateliers de 1985.. et bien entendu la grande grève des cheminots de 1919/1920.
La grève révolutionnaire mise en échec mais le « statut » obtenu
La nature singulière des transports ferroviaires (réseaux monopolistes), de sa place dans l’économie, la guerre de 1914-18 et de la masse d’ouvriers qu’ils rassemblent, rendent plus stratégiques les oppositions internes entre le syndicalisme tenant du patriotisme cheminot, et le syndicalisme révolutionnaire « impressionné » par la révolution soviétique. En 1919 se mêlent ainsi des revendications relatives aux conditions de travail (la journée de 8 heures), à la « socialisation » des chemins de fer, et liées à la sortie de guerre (amnisties, démobilisation…). On critique aussi la discipline militaire des chemins de fer.. et l’attitude des syndicats.
Le 1er mai 1919 – où les cheminots furent réprimés avec violence – crée une situation favorable à la grève générale… mais elle n’advint pas, pas plus qu’en juin, et en juillet. Il fallut attendre février 1920 pour que la grève générale soit décidée. Les revendications portent alors sur le statut du personnel (!), l’échelle de traitement, la suppression des sanctions, la réorganisation des chemins de fer (nationalisation industrielle). Devant la possibilité d’une sortie de grève sur la base d’un arbitrage gouvernemental satisfaisant les revendications sociales (et non celles relatives à la nationalisation), le débat fit rage parmi les cheminots, les « révolutionnaires », minoritaires devenant majoritaires et décidant d’une grève générale. Marcel Cachin considèrera que, pour la première fois, le 1er mai revêtait un caractère révolutionnaire. La convergence des actions des mineurs, des marins et des dockers avec les cheminots renforce alors le mouvement. Le gouvernement engage alors des procédures contre les leaders du mouvement, parfois pour complot contre la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat. La CGT annonce l’extension du mouvement, puis se résigne au bout de deux semaines à appeler à la reprise du travail. Une reprise qui est désavouée par la minorité qui poursuit la grève. Cette issue se traduit – outre par le maintien de la révocation de nombre de cheminots – par des actions violentes, et un approfondissement du fossé entre les deux tendances du syndicalisme, et contribua à la création de la CGTU en 1922.
La grève dura donc en gros du 1er au 29 mai. Selon Rolande Trempé (Voix Libres, 1997), la grève regroupa autour de 160 000 agents sur 329 962, avec de fortes différences selon les réseaux. De plus le gouvernement et les compagnies contribuèrent à décapiter le mouvement et assurer un niveau significatif de circulation des trains. (on parle de 18 000 révocations). La contrepartie de la « défaite syndicale» fût cependant la satisfaction – imposée par le gouvernement aux compagnies – de revendications centrales comme le statut cheminot unifié (impliquant les syndicats). La conquête du « statut », à propos duquel Briand avait fait une ouverture dès 1910 après une grève des cheminots, en est sans doute le principal symbole.
La grande grève des routiers (transport de marchandises) de 1984
La grande grève des routiers de 1984 n’a pas, loin s’en faut, le même caractère politique que celle des cheminots de 1920, bien que certains l’ont cru. En revanche ce qui frappe en elle est son caractère global (elle mobilise artisans et salariés, bref les conducteurs), consécutif à une accumulation de grèves des services frontaliers italiens.
Il fait suite à une première série de blocages en 1982 qui étaient essentiellement dûs aux PME du secteur, sur des thèmes comme la détaxation du gazole (la TVA n’était pas à l’époque récupérable sur les carburants), la taxe professionnelle et les taux de crédit. Il s’agissait donc là de revendications économiques patronales unifiant un grand nombre de PME. Il apparaît à une époque marquée, en amont, par la préparation de la Loi d’Orientation des Transports Intérieurs, passablement perturbée d’une part par les travaux de la commission « Kahn » dont certaines hypothèses de travail ressemblaient aux propositions de certains cheminots CGT après guerre, rejetées alors par la CGT-Route, et d’autre part aux procès d’intention de certains syndicats patronaux. Enfin c’était aussi l’époque de la préparation du plan et de ses débats en commission, et de la publication du décret « social » 82/440 pris pour application de la loi des 39 heures.
En pratique, on n’a jamais pu identifier avec précision quel était le degré de préparation d’un mouvement qui, déclenché le 15 février dura jusqu’au 1er mars, malgré les appels, sans effet, à la levée des barrages de la part des syndicats patronaux (FNTR et UNOSTRA) dès le 19 février.
Ce mouvement est donc largement basiste. Il a pu affoler une partie des pouvoirs publics et des organisations patronales, prises de court, en raison de la mémoire des mouvements ayant fait chuter S. Allende au Chili. Jean Daniel dira qu’il permit aux routiers « d’accéder à l’existence sociale ».
Le conflit déboucha sur un ensemble de mesures assez simples, mais passa par une intervention directe sur le terrain (Francis Rol Tanguy). C’est ainsi qu’émergea un leader (M. Vasseur) et que 223 routiers « lésés » furent indemnisés pour leur permettre de quitter les barrages « dignement ».
En réalité, le traitement concret des sujets « au cœur » de la révolte des conducteurs a permis de régler un conflit que d’aucuns, dans l’appareil d’Etat souhaitaient réduire par la force. Mais si dans la mémoire collective cette « grande grève » garda une place singulière, ça n’est pas à cause de sa dimension sociale (au sens des conditions de travail et de rémunération), mais humaine et sociétale, les routiers en barrant les routes conquirent l’opinion publique, et leur firent connaitre la réalité de leur existence. Et de fait, la conclusion de ce conflit se centrait essentiellement sur la résolution des problèmes de passages de frontières, d’abonnements autoroutiers, de circulation et de viabilité hivernale, ou de retours à domicile facilités le week-end.
Même s’il connut des soubresauts, ce conflit, en obtenant la reconnaissance inattendue de Jacques Delors, apparût comme une conquête de dignité, et rééquilibra sans doute la perception des différents acteurs du secteur et de sa place.
La batellerie, dernière profession archaïque en révolte
La politique des transports, la transformation réglementaire du transport routier, et les conséquences de l’arrêt prononçant la Carence de la politique Européenne des Transports, allaient projeter le transport routier dans une autre dimension, avec, bien sûr la création du marché unique. On passait pour ainsi dire d’un monde à l’autre. Mais pour l’instant, une autre grande grève symbolique allait secouer une profession : la batellerie.
Ce fût un mouvement non pas provoqué par un obstacle ou une entrave, mais par une erreur grossière d’appréciation du gouvernement (arbitrage interministériel). En gros, face à un niveau de productivité faible (1 transport par mois) et une volonté de retrait de la profession de bateliers âgés, les propositions du ministère ne franchirent pas l’étape interministérielle. En pratique, les bateliers n’acceptaient pas que leurs femmes, plus jeunes en moyenne, ne puissent pas partir en retraite avec une pension majorée, pour permettre au couple de se retirer. Le « déchirage » des péniches suggéré en 1984 risque alors de ne pas pouvoir se faire. En fait, la batellerie artisanale, ressent à la fois la marque de son déclin – engendrant des revendications génériques en faveur de la voie d’eau et sa modernisation –, la nécessité de bénéficier de la solidarité nationale, et les conséquences de la gestion calamiteuse de plusieurs de ses institutions et organisations professionnelles. Un compte rendu déclarant la prise en compte de ces revendications génériques, signée de la main du Ministre (Jean Auroux) permis de lever les barrages. Mais l’essentiel demeurait. Une pénurie d’activité dont la SNCF et les Compagnies Fluviales (navigant sur le grand gabarit) furent désignées comme les coupables. Ce qui entraîna, aux différents tours de rôle, une montée singulière de velléités de barrage au début de l’année 1986, accompagnée d’opérations « coup de poing », menées par un prétendu Comité Révolutionnaire d’Action Batelier (CRAB). L’enjeu principal est alors d’empêcher les « grandes compagnies » (armateurs fluviaux employant des salariés) de transporter des céréales.
La représentation du marché des transports chez la plupart des bateliers est alors encore celle du tour de rôle, où, chacun vient chercher son fret, et une mystique de la coordination des transports où l’Etat viendrait « doter » de fret les différents groupes d’acteurs. Il faut rappeler que le « tour » est perçu comme un régulateur, une assurance d’égalité, obtenu de haute lutte à l’époque de l’introduction des automoteurs, concurrençant les péniches halées. Rappelons enfin que « Le Front populaire, à la suite des grèves batelières de 1933 et 1936, a institué le tour de rôle obligatoire pour les artisans et mis en place une procédure de fixation des prix par l'Administration. (voir : Bernard Lesueur)
Au surplus, Vichy mettra la batellerie en état de réquisition permanente, régime qui ne disparut pas après-guerre. Cet arrière plan explique en partie la nature même du conflit, les bateliers revendiquant et obtenant finalement (par le Ministre C. Josselin) le maintien de leur privilège sur les transports de céréales. La sortie de ce conflit, sans doute le dernier en date est ainsi symptomatique… la disparition du tour de rôle et la libéralisation effective du marché fluvial interviendra bien plus tard, en janvier 2000 (directive européenne de 1996). C’est aussi le sentiment politique du Ministre que l’enjeu ne méritait pas un tel conflit… en pleine campagne électorale.
Les grèves routières de 1992 et 1996 : le contrat de progrès et ses difficultés
La conflit de 1992 est souvent appelé « grève du permis à points ». Ce premier mouvement était en 1992 fort prévisible et prévu.
En pratique il résulte directement d’un déficit ou d’une incompréhension d’écoute du ministère des transports. A l’étude depuis 1979, le permis à points est voté le 12 juillet 1989 et devait être mis en application durant l'été 1992. Comme nous le rapportons (Patrice Salini, Histoire de la politique des transports terrestres de marchandises en France depuis le milieu du XIXème siècle) : « Au Conseil National des Transports, les modalités de mise en oeuvre pour les conducteurs professionnels ont été longuement discutés, et principalement la question du nombre de points, six, qui étaient donnés à l’obtention du permis, celle des conditions de récupération des points, et consécutivement le problème de l’avenir des conducteurs salariés qui en viendraient à perdre tout ou une grande partie de leurs points. Les réunions au CNT - où on confronte, discute, mais ne négocie pas - mettaient en évidence une situation potentiellement explosive du côté des conducteurs ».
De nombreux acteurs l’ont expliqué aux ministres concernés en vain. Or, dans le même temps la situation des entreprises s’était tendue. C’est donc très logiquement que le conflit commença, avec en toile de fond, une lutte incertaine pour l’hégémonie entre « patronat, coordinations et syndicats ». Il dura du 29 juin au 8 juillet. Cette situation a pu, selon Joël Le Coq, à travers la confrontation entre organisations et coordinations face aux patrons, faire émerger des revendications sociales. Si le patronat des plus grandes entreprises parle essentiellement du permis à points, les artisans mettent en avant également les conditions de sous-traitance, et les salariés souhaitent également traiter de leurs conditions de travail. Une commission (Roché) fut mise en place sur le permis, et une négociation a pu déboucher sur un relevé de conclusions.
Les thèmes « sociaux » sont importants. Ils concernent la « suppression des équivalences » (qui permet de compter une heure de mise à disposition pour moins d’une heure de travail), et la baisse d’une heure du temps de travail équivalent à 39 heures, et différentes mesures touchant la durée de travail quotidien. Parallèlement des mesures furent prises pour « renforcer » les conditions d’accès à la profession, en conformité avec la directive de l’UE.
Un groupe de travail dit « groupe Dobias » fut mis en place pour déboucher sur ce qui pourrait constituer un « contrat de progrès ». Un accord « grand routier » fut signé fin 1994. Il faudrait sans doute revenir sur le contenu des travaux du groupe « Dobias ». Pour simplifier la thèse mise en avant alors était simple :
1. les pratiques ne sont pas conformes au droit, il faut donc adapter provisoirement le droit.
2. Il faut par la négociation que la pratique s’adapte au droit.
Bien entendu, la CGT ne partageait pas cette thèse.
Au fond la stratégie des syndicats signataires était d’obtenir une baisse du temps de travail des salariés (d’environ 10 heures/mois)… hélas dans un contexte économique défavorable.
En outre, le principe même d’accorder un temps d’adaptation posait un vrai problème juridique que nous avions souligné et qui avait conduit la CGT à ne pas signer l’accord. Il s’agissait donc, à travers l’action militante, de « faire appliquer l’accord », comme le rappelle Claude Debons (CFDT à l’époque). Cette situation a pu renforcer la force des syndicats signataires. C’est donc à travers ce double mouvement revendicatif et de syndicalisation qu’émerge alors dans la profession le sentiment que le conflit sera inéluctable tant il est difficile d’avancer dans les négociations avec le patronat.
C’est ainsi que la grève de 1996 succèdera à une journée d’action réussie lancée par la CFDT le 28 mai 1996. Cette journée fut l’occasion de tester les mots d’ordre syndicaux et la forme de mobilisation. Or c’est dans cet intervalle de temps que s’organise la rédaction d’un cahier revendicatif et les négociations entre centrales syndicales, alors que dans le même temps, la situation économique pousse certains patrons à manifester de leur côté (7 novembre).
Pour autant les organisations syndicales lancent (CGT, CFDT, FO, FNCR, CFTC) leur appel à la grève le 18 novembre. Un début en demi teinte fera douter la presse (« maigres troupes »), et le Ministre n’accorda rien. La médiatisation du conflit joua à ce moment un rôle significatif, et le mouvement enfla considérablement. Un peu plus tard, face à l’absence d’avancée significative de la part des organisations patronales et du gouvernement, l’ampleur du mouvement progressa encore avec une diffusion massive des barrages après le 24 novembre. La perturbation économique se fait alors sentir. La négociation, difficile, déboucha pour l’essentiel sur le départ anticipé des conducteurs à 55 ans (sous conditions). Comme le rappelle la CFDT (Routiers, les raisons de la colère) « aucun miracle ne se produit. Ni sur, le décompte des temps (…). Ni sur les salaires. »..
Il ne suffit pas de gagner pour gagner…
La grève de la SNCF de 1995 quand les grèves font tomber les gouvernements
Tout le monde connait cette grande grève, symbolique et considérable par ses conséquences politiques. Bernard Thibault a dit d’elle en 1997 (Voix libre) « La fatalité accordée aux politiques menées dans le pays pendant plusieurs années a reculé au profit d’un esprit de résistance affirmé comme tel ». Il en perçoit les suite futures : défense du service public.. et du statut. Mais cette grève restera dans l’histoire comme l’une des rares grèves victorieuses, entraînant avec elle une partie du plan Juppé, et in fine le changement de premier ministre AlainJuppé, (mai 1997-Juin 1997), puis des élections législatives. Le déclenchement du mouvement de grève découle directement de l’annonce de la réforme su système de protection sociale par le premier ministre le 15 novembre (appel du 16 novembre pour une grève le 24, et déclaration commune des syndicats du 20). Comme ce sera le cas dans le mouvement routier de 1996, le mouvement syndical pris ici la direction du mouvement, contrairement à des grèves précédentes. Au bout de trois semaines de grève le bilan pour les cheminots fût le recul gouvernemental sur les régimes spéciaux (et de la fonction publique), et le recul sur le « contrat de plan ». L’articulation de deux thèmes aussi différents que la question du régime social particulier et du contrat de plan peut sembler singulière. Nous avions souligné fin 1995 (Patrice Salini, Bulletin des Transports n° 2638), que ce « contrat de plan » avait été préparé dans la précipitation, mais il cristallise les oppositions syndicales en ce qu’il synthétise des menaces pour les cheminots. En réalité on sent bien que le « changement de contexte » (concurrence, ..) et la non résolution des problèmes (dette) fait craindre pour l’emploi et les conditions de travail. Le contrat de plan sera le symbole de cette crainte, sans doute.
C’est à la fois son côté massif dans la durée, et son impact politique qui fit de cette « grande grève » un conflit référence, le « plus grand succès depuis 1968 ».. une sorte de reconquête de « dignité ».
Les mouvements décrits ici qu’ils soient victorieux ou non ont eu un impact fort en ce qu’ils exprimaient quelque chose ayant un rapport avec la dignité, l’existence sociale, et suscité un soutien populaire. Le regard sociologique qu’on peut porter sur eux ne doit pas ignorer la mise en perspective historique. … qui elle permet de mesurer le degré d’échec à moyen terme. Il ne suffit pas de gagner pour gagner pourrait-on dire.
La question sociale et l’ouverture européenne
A quoi peut-on s’attendre aujourd’hui en ce qui concerne les conflits sociaux du transport dans un contexte qui est aussi celui d’ouverture Européenne ? Deux grandes hypothèses doivent être envisagées :
Dans la première, les conflits sociaux dans le transport vont perdre de leur virulence dans la mesure où une règlementation Européenne du transport s’est imposée progressivement pour le transport routier d’abord puis pour le transport ferroviaire avec l’ouverture à la concurrence qui vient de franchir une dernière étape, incluant le transport de voyageurs à courte et longue distance.
Dans la deuxième, ils se manifestent de manière différente dans une contestation plus globale, en lien avec d’autres catégories sociales comme le laisse suggérer le dernier mouvement des gilets jaunes, dans un mouvement de contestation plus transversal et international. Dans ce cas il ne faut pas oublier que les employés du transport peuvent y apporter une capacité de blocage et de nuisance des plus déstabilisantes pour l’économie, et la vie quotidienne à l’échelle nationale voire internationale et ce d’autant plus que les systèmes politiques seront mal assurés dans leurs fondements démocratiques.
En fait ces deux hypothèses ne sont pas antinomiques, et la première peut donner le sentiment que les choses finissent par se régler en matière sociale, face à la force des mécanismes économiques que l’Europe à insuffler avec l’ouverture des marché et l’intégration de nouveaux pays membres qui se sont avérés beaucoup plus compétitifs, du moins en transport routier, du fait d’un dumping social qui se manifeste de manière indirecte avec un jeu d’implantations d’opérateurs à l’étranger, de sous-traitance et la multiplication d’auto entrepreneurs à partir de pays où le revenu moyen est beaucoup plus faible. Ce mécanisme a très bien été décrit dans « Transport Routier Européen : peut-on sortir de l’impasse ? » (Patrice Salini) . C’est un sujet qui avait été abordé lors des « rencontres de Barbizon » organisées par l’Inrets avec nos collègues des Pays d’Europe Centrale et Orientale (PECO) dans les années 1990.
Mais la question sociale n’a pas pour autant été réglée et c’est pour cela que la deuxième hypothèse est toujours ouverte, car on ne peut pas penser qu’elle finira par trouver rapidement un équilibre grâce à la seule convergence des économies.
La question ne peut donc que resurgir de manière plus globale, comme le laissent déjà entrevoir les difficultés que l’on a à trouver des conducteurs en Europe de l’Ouest. Pour le chemin de fer, mode sensiblement plus capitalistique, les évolutions seront certainement plus lentes, mais rien ne garantit que des problèmes analogues ne vont pas surgir lorsque le nombre de nouveaux entrants va se multiplier.
Un tel risque est d’autant plus préoccupant qu’il y a l’apparition de nouveaux métiers et d’auto-entreprises, VTC, livraison VUL, ou deux-roues…pouvant pour lesquelles se pose aussi la question des conditions de travail, et qui sont des activités qui peuvent provoquer de nouveaux types de blocages notamment en zones urbaines …
En outre, on peut craindre que l’Europe montre la même incapacité à comprendre ces enjeux sociaux, et continue à ne pas les connaître par manque d’un système d’observation adéquat, et finalement les reconnaître, et les intégrer.
Tout ceci trouve une explication dans l’histoire même de l’Europe, avec la primauté accordée à l’économie, voire plus récemment à l’environnement, la représentation des acteurs sociaux restant dans un rôle consultatif au sein d’un CESE, avec des organisations patronales et ONG, sans pratiquer un lobbying aussi efficace. Quant à l’union syndicale au niveau de l’Europe, elle est loin d’avoir l’influence qu’elle a pu avoir historiquement pour promouvoir l’idée de l’Europe, rôle vite oublié, et peut difficilement, aujourd’hui, exprimer des propositions communes applicables pour des secteurs particuliers comme les transports. Outre la difficulté intrinsèque à traiter la question sociale des transports, il y a en plus une question institutionnelle de représentation sociale à l’échelle de l’Europe dont il faut aussi être conscients.